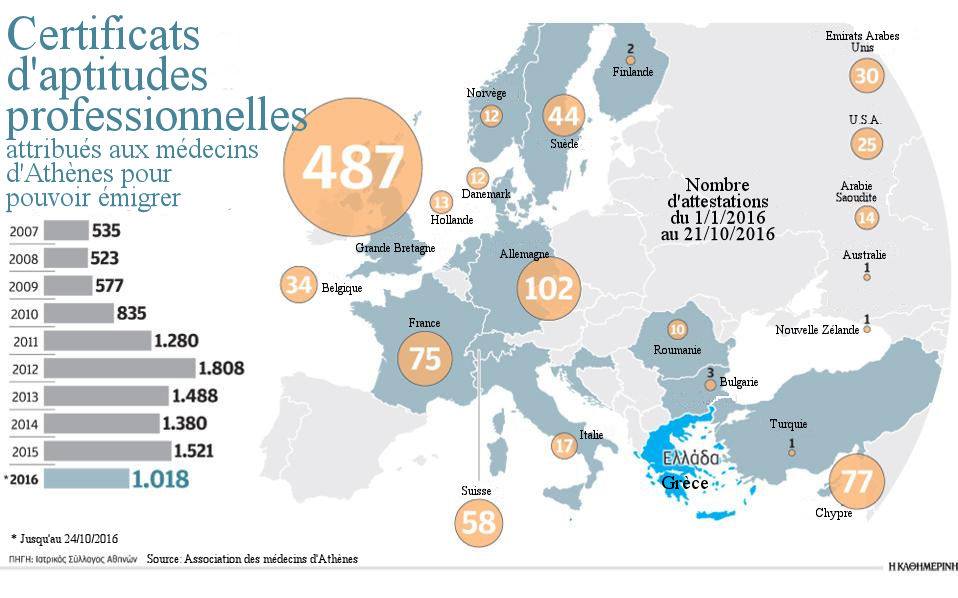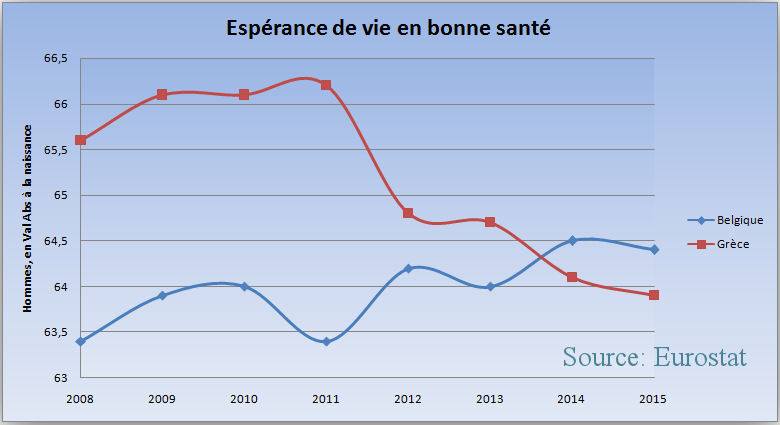samedi 28 octobre 2017
Deux écritures d'un même évènement...
Par Olivier Delorme, samedi 28 octobre 2017 à 16:59 :: Nouvelles de Grèce réenchaînée
J'ai écrit deux fois dans ma vie sur le NON grec à Mussolini, du 28 octobre 1940, que les Grecs commémorent aujourd'hui, puisque c'est la date de leur seconde fête nationale (la première est le 25 mars, anniversaire du début de la guerre d'indépendance de 1821).
La seconde fois, c'était en historien, dans La Grèce et les Balkans (texte ci-dessous, Folio Histoire, Gallimard, 2013).
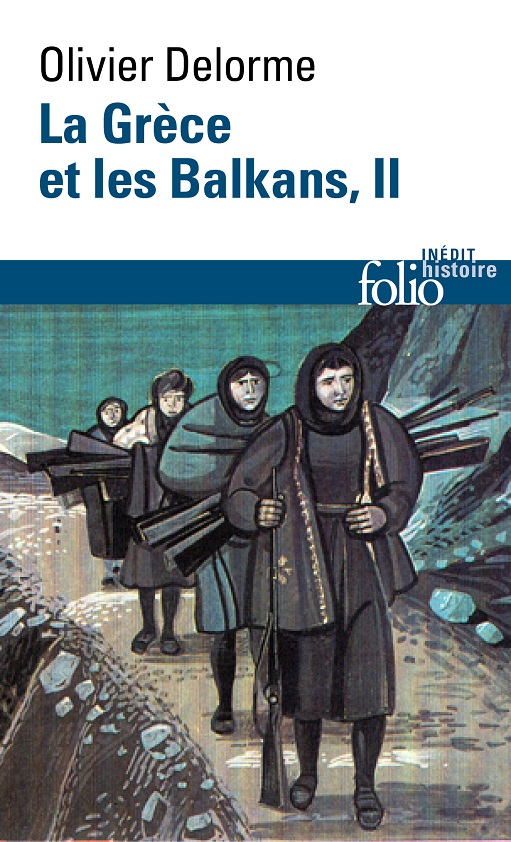
Ce NON (que Tsipras instrumentalisa à merveille, en 2015, avant de transformer le résultat du référendum en OUI) est pourtant plein d'ambiguïtés puisqu'il fut prononcé par un homme qui, en août 1936, avait établi par un coup d'Etat commandité par le roi, devant la montée de la colère sociale (effets de la crise de 1929) et le blocage du système politique, un régime qui puisait son idéologie dans le fascisme italien et avait converti l'économie grecque vers une totale dépendance de l'Allemagne nazie.
Or ce régime-là, pour des raisons patriotiques, dut dire Non à l'Italie fasciste qui l'agressait pour des raisons de susceptibilités mussoliniennes, mener la guerre contre elle, puis finalement, au printemps 1941, affronter l'invasion allemande. Rappelons aussi que les victoires grecque sur l'Italie furent les premières remportées contre l'Axe, et qu'elles forcèrent Hitler à venir en aide à son allié repoussé loin à l'intérieur de l'Albanie, au printemps 1941, de sorte que la résistance des Gréco-Anglo-Néo-Zélandais, en Grèce continentale d'abord, puis en Crète, forcèrent Hitler à différer le déclenchement de l'opération Barbarossa contre l'URSS et empêchèrent les Allemands d'arriver devant Moscou avant l'hiver. Ce que Churchill considéra comme le premier tournant de la guerre.
Rappelons aussi que les Grecs payèrent leur héroïsme puis leur Résistance rapide et massive d'une occupation allemande qui fut l'une des plus sauvages, destructrices et inhumaines (notamment une famine unique en Europe) d'Europe. Pour laquelle l'Allemagne, elle, n'a jamais rien payé, tout en protégeant consciencieusement les innombrables criminels de guerre et contre l'humanité qui ont sévi sur le sol grec.
"1-3 : Le « Non » de Métaxas et les victoires grecques en Albanie
Le 10 juin 1940, Mussolini avait voulu voler au secours de la victoire allemande afin de profiter lui aussi de la défaite française. Mais les Italiens avaient été contenus partout, et le Duce estima, à l’heure de l’armistice franco-italien du 24 juin, que le Führer n’avait rien fait pour que l’Italie obtînt son dû , alors que l’URSS profitait de la défaite française pour mettre la main sur la Bessarabie et la Bukovine du Nord !
Le Duce voulait donc sa revanche, et son état-major lui assurait que l’invasion de la Grèce ne serait qu’une promenade de santé. Entre l’Albanie et les bases aéronavales de Tarente et du Dodécanèse, l’Italie disposait de toute la logistique nécessaire à une telle opération. Quant à l’Angleterre, elle n’aurait pas même le temps d’intervenir avant l’entrée du Duce à Athènes. En eût-elle le désir, au risque d’affaiblir la défense de Suez, alors que la Syrie et le Liban sont restés dans l’obédience de Vichy, et que, le 3 juillet, les Britanniques désarment sous la menace la flotte française d’Alexandrie – ou détruisent celle de Mers el-Kébir.
Durant l’été, la propagande italienne se fait plus agressive vis-à-vis de la Grèce et s’emploie à mobiliser contre elle sa minorité albanaise d’Épire, dénonçant d’imaginaires persécutions grecques. Cette stratégie de la tension culmine le 15 août, alors que les Grecs célèbrent la Dormition de la Vierge, la fête religieuse la plus importante après Pâques, notamment dans l’île de Tinos où l’on vient en pèlerinage de tout le pays pour vénérer une icône miraculeuse. C’est ce jour-là qu’un sous-marin italien venu du Dodécanèse torpille, en rade de Tinos, le vieux croiseur grec Helli, envoyé représenter la marine hellénique, dont la Vierge est aussi la protectrice, tandis que deux autres torpilles explosent contre le quai où se presse la foule des pèlerins – sans faire de victimes, ce que l’opinion grecque tiendra pour un miracle. L’émotion dans le pays n’en est pas moins immense, tandis que Métaxas interdit la publication des résultats de l’enquête officielle identifiant l’origine italienne des torpilles. C’est que le dictateur croit encore pouvoir éviter la guerre en faisant appel à Berlin ; Berlin qui recommande à Athènes de ne pas mobiliser en réponse aux concentrations de troupes italiennes le long de la frontière albanaise.
Pour les Allemands, la Grèce ne présente pas de véritable intérêt. Même si elle penche pour l’heure vers l’Angleterre, principalement en raison du danger italien, ses faibles moyens militaires lui interdisent de rompre une neutralité qu’elle a proclamée le 3 septembre 1939. Son régime est anticommuniste, idéologiquement proche de l’Axe et son économie très liée au Reich qui, au moment où il prépare pour le printemps l’invasion de l’URSS, souhaite éviter les turbulences dans la région, voire une intervention soviétique dans les Balkans que pourrait provoquer une attaque italienne en Grèce. Le 4 octobre 1940, lors d’une rencontre au Brenner, Hitler interdit donc toute initiative à Mussolini. L’Italien tente de convaincre l’Allemand qu’il est capable de régler rapidement le sort de la Grèce, mais il se heurte à une fin de non-recevoir. Puis, dans les jours qui suivent, il apprend l’entrée des nazis en Roumanie… sans qu’Hitler ait cru bon de l’en informer. Ciano, qui considère la guerre contre la Grèce comme une formalité et qui en parlera devant Emanuele Grazzi , son ambassadeur à Athènes, comme de la mia guerra, rapporte dans son Journal la réaction ulcérée de son beau-père :
« Hitler me met toujours devant le fait accompli ! Je vais le payer cette fois-ci de la même monnaie. Il va apprendre par les journaux que je suis entré en Grèce. Ainsi l’équilibre sera rétabli . »
Le 23 octobre, sachant le Führer à Hendaye, où Franco lui énumère les innombrables conditions que l’Espagne met à son entrée en guerre, le Duce lui écrit à Berlin pour l’informer de la prochaine initiative italienne. Hitler, qui rencontre Pétain à Montoire le 24, ne prend connaissance de la missive que le 25 et demande aussitôt une entrevue à Mussolini. Le 28, à Florence, ce dernier l’accueille à sa descente du train par un triomphant : « Führer, nous sommes en marche ! »
Ce même jour, à 3h00 du matin, Grazzi, qui vient de recevoir le Tout-Athènes en l’honneur de la présence du fils de Puccini à l’inauguration de l’Opéra royal (où une jeune chanteuse nommée Maria Callas a signé un contrat de choriste en juin ), a en effet tiré de son lit le dictateur grec pour lui remettre un ultimatum… expirant à 6h00 ; il exige la libre circulation sur le territoire grec des troupes italiennes et l’occupation de diverses positions stratégiques. Le « Non » (Όχι en grec) de Métaxas soulève dans le pays un enthousiasme patriotique qui transcende les clivages politiques. Alors que les communistes roumains n’ont cessé de se trouver en porte-à-faux par rapport à leur société, sur la question nationale, en soutenant les annexions soviétiques de 1940, les communistes grecs se placent, malgré le pacte germano-soviétique (dont, il est vrai, l’Italie n’est pas signataire), dans une logique d’union sacrée. C’est ce qu’exprime la lettre ouverte qu’écrit de sa prison Nikolaos Zachariadis (premier secrétaire du KKE depuis 1931, secrétaire général en 1935), le 31 octobre, et que s’empresse de publier le très anticommuniste Maniadakis, ministre de l’Ordre public :
« Au peuple de Grèce.
Le fascisme de Mussolini a frappé la Grèce dans le dos, d’une manière criminelle, sans vergogne, dans le but de la soumettre et de l’asservir. Aujourd’hui, nous tous, Grecs, luttons pour la liberté, l’honneur, notre indépendance nationale. La lutte sera très dure et très rude. Mais une nation qui veut vivre doit lutter en ignorant dangers et sacrifices. Le peuple de Grèce mène aujourd’hui une guerre de libération nationale contre le fascisme de Mussolini. À côté du front principal, chaque rocher, chaque ravin, chaque village, masure par masure, chaque ville, maison par maison, doit devenir une citadelle du combat de libération nationale.
Chaque agent du fascisme doit être éliminé sans pitié. Dans cette guerre que conduit le gouvernement Métaxas, nous tous devons donner toutes nos forces, sans réserve . La récompense du peuple travailleur, le couronnement de son combat d’aujourd’hui, devra être et sera une nouvelle Grèce du travail, de la liberté, affranchie de toute dépendance étrangère et impérialiste, dont la civilisation sera vraiment celle du peuple tout entier.
Tous au combat, chacun à sa place, et la victoire sera la victoire de la Grèce et de son peuple. Les travailleurs du monde entier se tiennent à nos côtés . »
Conformément à cette ligne, qui renvoie les changements politiques et sociaux au lendemain de la victoire, nombre des dirigeants du KKE sollicitent alors de Métaxas leur libération afin de s’engager dans son armée. En vain. Car si ce « Non » du 28 octobre (seconde fête nationale depuis 1944, avec le 25 mars commémorant le début de la guerre d’indépendance) exprime un sentiment populaire largement partagé, il est celui d’un dictateur qui n’entend rien changer à son régime.
« Quand survint le « Non » – analyse Séféris – Métaxas n’a pas compris que c’est alors seulement qu’il avait le peuple tout entier avec lui (…). L’eût-il même compris que son amour-propre l’empêcha de faire le seul geste que dictait pareil instant : renvoyer chez eux la bande d’incapables qui l’entouraient et appeler, au contraire, tous ceux qui pouvaient l’aider dans le dur combat que notre peuple était sur le point d’entreprendre. Mais tous ces médiocres, ces pleutres, ces petits combinards que n’habitait rien d’autre que la crainte révérencielle de l’Allemagne, il les garda. (…) Le peuple tenta vainement de faire comprendre à Métaxas ce changement radical de situation.
(…) Le « Non » signifiait que la Grèce allait livrer la guerre la plus difficile de son histoire, aux côtés de ceux qui attaqueraient les forces fascistes. Seulement, l’État grec était lui-même fasciste. Alors comment concilier ces deux données ? Eh bien les hommes de Métaxas trouvèrent une solution d’une grossière subtilité : nous n’étions absolument pas en guerre contre l’Axe. (…) Notre guerre était seulement contre l’Italie. Bien plus : nous étions seulement en guerre contre les forces armées italiennes . »
Sur le terrain , les premières troupes italiennes sont entrées en Grèce à 5h30 (soit une demi-heure avant l’expiration de l’ultimatum), suivant trois axes. Elles progressent plus lentement que prévu sur la côte ; au centre, dans le massif du Pinde (1500 m d’altitude), elles parviennent à prendre Konitsa à une dizaine de kilomètres de la frontière ; à l’est, en direction de Florina, elles sont rapidement stoppées. La supériorité numérique des Italiens est massive : ils disposent de 27 divisions bien équipées. Les Grecs ne peuvent que leur en opposer une, 15 autres s’y ajouteront au fur et à mesure de la mobilisation décrétée après l’attaque. Mais les soldats grecs se montrent d’emblée plus motivés, et les conditions climatiques exécrables amoindrissent l’avantage écrasant des Italiens en matière d’armement. L’aviation attaque les ports de Patras, du Pirée, de Corfou, de Volos, le canal de Corinthe, le nœud ferroviaire de Thessalonique, etc., mais elle ne peut appuyer efficacement les troupes au sol ; la progression des blindés et camions est ralentie ou empêchée par le relief et les cours d’eau en crue. De plus, les troupes grecques bénéficient de la connaissance d’un terrain particulièrement difficile et du soutien actif de la population civile : l’impréparation du commandement, la mobilisation tardive, l’absence de routes et de moyens de transmission modernes, le manque de camions et même d’ânes, font dépendre le ravitaillement des combattants, en vivres comme en munitions, des femmes et des enfants de la région qui les transportent à pied, sur leur dos, jusqu’au front.
Dès le 6 novembre, les Grecs, qui se battent à un contre quatre dans ce secteur, attaquent la division alpine Julia qui, depuis Konitsa, s’est avancée en direction de Metsovo. Le 13, cette unité d’élite repasse la frontière : elle a perdu près de 20 % de ses effectifs. Ce revers contraint les Italiens qui ont progressé le long du littoral à retraiter rapidement ; humilié, Mussolini remplace le commandant en chef mais, le 14 novembre, le général Papagos lance une offensive d’envergure. À Korçë, ses troupes infligent une sévère défaite à la IXe armée italienne, pourtant puissamment mécanisée, tandis que, dans la nuit du 11 au 12, un raid de l’aéronavale britannique sur Tarente détruit ou endommage gravement la moitié des bâtiments importants de la flotte fasciste, permettant de sécuriser les liaisons maritimes entre l’Égypte et la Grèce. À la fin de janvier 1941, le front s’établit entre 25 et 55 km au Nord de la frontière albanaise et les Grecs sont maîtres de Chimara/Himarë, Saranda/Sarandë, Argyrokastro/Gjirokastër, et Koritsa/Korçë. Dans cette Épire du nord à majorité grecque qui s’était soulevée lors des guerres balkaniques pour obtenir son rattachement à la Grèce, mais n’en avait pas moins été attribuée à l’Albanie par les Puissances en 1913 et en 1921, l’armée hellénique est en outre bien souvent accueillie en libératrice, et organise une légion de déserteurs gréco-albanais qui combat à ses côtés.
Ces victoires, les premières de la guerre contre une armée de l’Axe, ont un immense retentissement international : à l’entrée de Menton, occupée par les Italiens, des résistants français plantent un panneau où est inscrit l’avertissement suivant : « Soldats grecs, halte ! Ici, territoire français ! » ; un autre, à Vintimille, proclame : « Si vous voulez visiter l’Italie, engagez-vous dans l’armée grecque . » C’est que les émissions en français de la BBC donnent une large place à la guerre d’Albanie. On y évoque Hugo, Fabvier et l’expédition française de Morée lors de la guerre d’indépendance ; Jean Marin (14 mars 1941) y exalte le courage du petit peuple agressé : « On ne dira plus : les Grecs se battent comme des héros. Le monde dit déjà : les héros se battaient comme des Grecs . »
Quant à Maurice Schumann, il dénonce l’agression, dans « Honneur et patrie », dès le 29 octobre 1940 :
« Depuis hier, les dictateurs se sont lancés à l’assaut de l’Acropole. Ce symbole manquait à leurs forfaits. Il ne leur a pas suffi de dresser leur défi monstrueux contre vingt siècles de civilisation chrétienne. Emportés par l’orgueil qui les mène à leur perte, ils vont traquer l’humanisme jusque dans son berceau. (…) Comment oublierions-nous que la France ne serait pas la France si l’Hellade n’avait pas été l’Hellade, si l’éternelle Antigone, face à l’éternel Créon, n’avait pas proclamé l’invincible suprématie de la loi morale sur la violence aveugle ? »
L’armée hellénique n’en est pas moins dans une situation précaire : la ligne Métaxas a absorbé l’essentiel des crédits militaires depuis 1936, les quelques chars sont totalement dépassés, l’artillerie de campagne n’est pas plus moderne – plus d’un canon tue ses servants en explosant – et, en dehors des 5 Morane livrés par la France en janvier 1940, l’aviation se réduit à une dizaine d’avions modernes dont les pilotes n’ont parfois pas même terminé leur formation, contre 101 bombardiers et 54 chasseurs italiens. L’intendance peine à ravitailler des soldats qui vivent et se battent dans des conditions d’une extrême dureté ; on manque de tout, de chaussures comme de couvertures : on tricote beaucoup, en Grèce, durant ces mois, mais les ouvroirs des dames de la bonne société athénienne ne suffisent pas à empêcher pieds et mains de geler. Le service de santé est lui aussi insuffisant et peu familier des pathologies dues au froid : les amputés remplissent les hôpitaux, la gangrène et les pneumonies tueront, au total, autant que les balles italiennes. Enfin, si la mobilisation de l’arrière est totale et les manifestations populaires contre l’Italie quotidiennes, l’armement du fantassin grec est français ou allemand : les livraisons de munitions et de pièces de rechange ont cessé, les stocks s’épuisent. Devant cette situation lourde de menaces, Métaxas s’est résolu à accepter une aide des Britanniques : dès les jours qui suivent l’attaque italienne, ils débarquent en Crète afin d’assurer la défense de l’île, stratégique pour la sécurité du canal de Suez et, de novembre 1940 à janvier 1941, cinq escadrons de bombardiers et de chasseurs de la RAF arrivent en Grèce – malgré l’opposition du général Wavell, commandant en chef au Proche-Orient, qui, après avoir repoussé les Italiens d’Égypte, conduit alors une offensive en Libye (Tobrouk tombe le 22 janvier, Benghazi le 6 février). 350 000 paires de chaussettes, 180 000 de brodequins , des couvertures et des armes prises aux Italiens en Libye sont expédiées en Grèce. Mais la visite à Athènes, le 14 janvier, de Wavell et du maréchal de l’Air Longmore, commandant des forces aériennes britanniques d’Aden aux Balkans, aboutit à une impasse : Métaxas et Papagos réclament neuf divisions ainsi qu’une force aérienne en rapport, et refusent les trois divisions, l’artillerie, les blindés légers et les quelques avions proposés par les Anglais, estimant que les accepter reviendrait à « provoquer » Hitler. Les offres de service des Français libres ne sont pas traitées différemment. Dès avant l’armistice, le directeur de l’Institut français, Octave Merlier , avait pris l’initiative d’envoyer au maréchal Pétain un télégramme, faisant référence aux Athéniens qui, en 480 avant notre ère, avaient choisi de quitter leur cité plutôt que d’accepter la soumission aux Perses, avant d’emporter sur mer la bataille de Salamine. Puis il avait télégraphié son ralliement au général de Gaulle dont il était devenu le représentant à Athènes, et avait activement participé à la formation d’un Comité des Français libres de Grèce, qui pourra compter sur la sympathie d’environ 20 % des Français d’Athènes et du Pirée, mais auquel le pouvoir interdit de faire la moindre publicité (on y tricotera aussi beaucoup pour les soldats du front). Par ailleurs, dès le 2 novembre 1940, de Gaulle envoie un message à Métaxas :
« En se dressant une fois de plus, pour sauvegarder leur indépendance, les Hellènes donnent au monde un exemple digne de leurs traditions antiques. Ensemble, avec nos alliés, nous vaincrons nos ennemis communs.»
Et le dictateur lui répond le 4 :
« La Grèce tout entière est convaincue qu’en ces graves moments de son histoire les cœurs de tous les Français sans exception battent pour le succès de sa juste cause. La grande nation française, qui a tant de fois suivi le noble exemple de nos ancêtres et qui nous a vaillamment soutenus lors de nos guerres pour l’indépendance, ne pouvait que se mettre une fois de plus à nos côtés. »
Quand de Gaulle parle d’alliés et d’ennemis communs – au pluriel, c’est-à-dire aussi de l’Allemagne –, Métaxas n’évoque que la juste cause de la Grèce et « tous les Français sans exception », c’est-à-dire également ceux de Vichy dont les représentants sont seuls accrédités auprès de son gouvernement. De Gaulle ne se décourage pas ; il veut voir les Français libres combattre sur tous les champs de bataille, envisage la formation d’une légion de volontaires recrutée dans les communautés françaises de Grèce et des Balkans. Puis, cette solution se révélant irréaliste, il demande à plusieurs reprises aux Anglais d’acheminer en Grèce un détachement des troupes qui ont rallié la France Libre au Proche-Orient. Wavell refuse, les Britanniques n’ayant eux-mêmes aucune unité combattante en Grèce, et les Français libres faisant partie du dispositif de défense de l’Égypte. Le 27 novembre, de Gaulle n’en revient pas moins à la charge, cette fois auprès du chef de l’état-major impérial, sir John Dill :
« Quelle que soit l’importance des raisons purement militaires que vous voulez bien me donner comme s’opposant à l’envoi de ce détachement, elles n’ont pas, à mes yeux, la valeur considérable que revêtirait, au point de vue politique et moral pour la France, la présence d’une troupe française combattant en Grèce . »
Les Anglais ne céderont pas ; mais, de toute façon, les ambassadeurs de Métaxas à Londres et au Caire indiquent qu’Athènes entretient de bonnes relations avec Vichy, que la Grèce n’est pas en guerre contre l’Allemagne, et qu’en conséquence l’envoi de Français libres sur le front d’Albanie n’est pas plus possible qu’est opportune la venue à Athènes, pour en discuter avec l’état-major, du capitaine de Chevigné, nommé à cette fin par le général Catroux .
Les responsables grecs veulent-ils au demeurant vraiment gagner cette guerre ? Certains analystes, après 1945, contesteront en tout cas la stratégie adoptée, notamment les opérations à l’est du front, sans réel objectif, alors que, à l’ouest, le port stratégique de Valona/Vlorë semblait à portée, au début de 1941, d’une offensive massive. De fait, l’ambiguïté du régime Métaxas demeure : la Grèce fait la guerre à l’Italie tout en espérant une paix blanche de l’arbitrage d’Hitler et, pour obtenir cette médiation, son ambassadeur à Berlin promet aux nazis… de s’opposer par la force à toute entreprise britannique en Grèce. Funeste erreur et de lourde portée. Car si Hitler est furieux contre Mussolini qui a enfreint ses instructions, si Ciano se le voit vertement reprocher le 18 novembre à Salzbourg, si le Duce envisage lui-même de solliciter la médiation du Führer, celui-ci ne peut tolérer de voir son allié ainsi humilié : le 13 décembre 1940, il signe le plan d’intervention allemand en Grèce et, le 20 janvier 1941, il décide l’envoi en Libye de l’Afrikakorps (Rommel débarque à Tripoli le 12 février).
Pas plus que l’attaque italienne, la mort de Métaxas (29 janvier 1941) ne conduit le roi à rompre avec son régime : il nomme Premier ministre le très terne gouverneur de la Banque nationale, Alexandros Koryzis, et reconduit la plupart des ministres, dont Maniadakis, symbole de la répression. Puis Georges II, qui a toujours été plus proche de Londres que Métaxas, décide d’accepter l’aide anglaise : le 22 février 1941, le secrétaire au Foreign Office, Anthony Eden, ainsi que les généraux Dill, Longmore et Wavell sont à Athènes. Mais il est déjà bien tard !
Depuis plusieurs semaines, les Britanniques alertent en effet les Grecs sur l’arrivée en nombre de « civils » allemands en Bulgarie et, le 9 février, Winston Churchill a rendu ces avertissements publics dans une allocution radiodiffusée :
« Une armée et une force aérienne allemandes considérables sont concentrées en Roumanie, dont les tentacules avancés ont déjà pénétré en Bulgarie avec, nous devons le supposer, le consentement du gouvernement bulgare. Les aérodromes sont occupés par un personnel au sol allemand de plusieurs milliers d’individus, afin de préparer l’arrivée d’une force aérienne allemande qui entrera en action à partir de la Bulgarie. Bien des dispositions ont été prises en vue du mouvement des troupes allemandes vers ou à travers la Bulgarie. Et peut-être ce mouvement en direction du sud a-t-il déjà commencé. »
Métaxas et le roi partagent donc une écrasante responsabilité dans le fait d’avoir si longtemps différé l’arrivée de forces britanniques sur le sol grec afin de parer à une attaque allemande depuis la Bulgarie. Et encore, lorsque le 1er mars cette dernière adhère au pacte tripartite, permettant un déploiement officiel de l’armée allemande sur son territoire, les instructions que Séféris reçoit de son ministre sont-elles de surseoir à la diffusion de la nouvelle dans la presse et d’éviter les commentaires, les « assurances » allemandes n’ayant pas varié :
« Non, vraiment, est-il Dieu possible qu’aujourd’hui, après tout ce que nous avons subi, tant de catastrophes, tant de sang versé sur le front, après le miracle révélant l’âme collective de notre armée, oui, est-il convenable qu’il se trouve des individus pour vous dire qu’ils croient aux « assurances » des Allemands (…) ? Bande d’eunuques et je suis modéré ! »
Le 9 mars, l’Italie lance son offensive de printemps qui aboutit rapidement à un nouvel et cuisant échec, les Grecs en profitant pour progresser de nouveau en direction de Vlorë, tandis que la flotte fasciste se fait durement étriller par les Britanniques, le 18, au large du cap Matapan (Magne). Mais les Néo-Zélandais, Australiens, Polonais et Anglais du corps expéditionnaire (de Gaulle n’a pas obtenu l’envoi de Français, les Anglais manifestant ainsi que la Grèce est en somme leur chasse gardée) ne commencent à débarquer que le 7 mars. Au surplus, Eden a promis plus qu’il ne peut tenir dans une opération imposée aux militaires par les politiques. Car Wavell n’est favorable qu’à une fortification de la Crète afin de couvrir le canal de Suez, et il s’est vigoureusement opposé à ce qu’on dégarnisse le front de Cyrénaïque pour engager des troupes dans une bataille de Grèce qu’il juge perdue d’avance. L’offensive que lance Rommel en Cyrénaïque, le 24 mars, ne fera que renforcer sa conviction : sur les 100 000 hommes qu’Eden a promis aux Grecs, il n’en arrivera que 62 000 – de surcroît très insuffisamment dotés en armement lourd. Certes la Grèce sera, avec l’Angleterre, la première bénéficiaire de la loi prêt-bail (11 mars) qui donne au président Roosevelt la latitude de « prêter » matériel, armes et munitions (ils seront en principe rendus ou remboursés à l’issue de la guerre) aux pays dont la défense est nécessaire à la sécurité des États-Unis, mais elle vient trop tard pour modifier l’équilibre des forces.
Churchill n’a d’ailleurs guère d’illusion sur les chances d’une victoire, mais l’intervention lui semble indispensable à double titre. D’une part, l’opinion américaine ne comprendrait pas que l’Angleterre laissât un petit pays, auquel elle a donné sa garantie, seul face à l’agresseur. Surtout, Churchill pense que ne pas venir en aide à la Grèce risquerait d’accentuer ce que Londres considère désormais comme une « attitude équivoque » d’Ankara. De fait, l’ambassadeur nommé par Hitler en 1939, l’ex-chancelier Franz von Papen (1879-1969), déploie une intense activité en Turquie, où la défaite française a, comme ailleurs, bouleversé les certitudes et où le Reich n’a cessé de renforcer ses positions économiques : en 1939, le partenaire allemand compte pour 52,37 % des importations et 42,05 % des exportations turques , tandis que Krupp a reconquis, depuis 1937, sa place de premier fournisseur de l’armée. Pourtant, la Turquie est signataire du pacte balkanique de 1934, dont le protocole annexe prévoit que :
« 2 – (…) Son but est de garantir la sécurité des frontières balkaniques contre toute agression de la part d’un État balkanique.
3 – Néanmoins, si l’une des Hautes Parties contractantes est victime d’une agression de la part de toute autre Puissance non balkanique et si un État balkanique se joint à cette agression, soit simultanément, soit ultérieurement, le Pacte d’Entente balkanique produira ses pleins effets à l’égard de cet État balkanique. »
Bien que l’Albanie fût un État balkanique, au moins en principe distinct de l’Italie, la garantie n’a pas joué au profit de la Grèce lorsque celle-ci a été attaquée depuis son territoire. Par ailleurs, le pacte tripartite anglo-franco-turc d’octobre 1939 dispose que :
« Art. 2 – 1) Dans le cas d’un acte d’agression commis par une Puissance européenne et conduisant dans la zone méditerranéenne à une guerre où la France et le Royaume-Uni seraient impliqués, la Turquie collaborera effectivement avec la France et le Royaume-Uni et leur prêtera toute l’aide et toute l’assistance en son pouvoir. (…)
Art. 3 – Aussi longtemps que demeureront en vigueur les garanties données par la France et par le Royaume-Uni à la Grèce et à la Roumanie par leurs déclarations respectives du 13 avril 1939, la Turquie coopérera effectivement avec la France et le Royaume-Uni et leur prêtera toute l’aide et toute l’assistance en son pouvoir, dans le cas où la France et le Royaume-Uni seraient engagés dans des hostilités du fait de l’une ou de l’autre des garanties susmentionnées . »
En principe, la Turquie devrait donc se trouver solidaire de l’Angleterre et de la Grèce ; en fait, elle argue de ses faibles moyens militaires et du « toute l’aide et toute l’assistance en son pouvoir » pour se cantonner dans une non-belligérance qui conduit Inönü à refuser, en janvier 1941, le déploiement sur le sol turc d’unités de DCA et des dix à quinze escadrons de la RAF que lui a proposés Churchill. Mais cette neutralité est devenue singulièrement équivoque avec la conclusion sous l’égide nazie, le 17 février, d’un traité bulgaro-turc qui, en précisant que le passage de l’armée allemande en Bulgarie ne sera pas considéré par la Turquie comme un casus belli, permet à la Wehrmacht de préparer en toute tranquillité l’invasion de la Grèce."
NB : détenu par les Allemands durant l'Occupation, Papagos devint ensuite l'homme des Américains, le vainqueur de la guerre civile et le Premier ministre d'un régime monarchique d'apparence démocratique, en réalité autoritaire qui se perpétua après sa mort jusqu'au début des années 1960, puis se prolongea, de 1967 à 1974, par la dictature des Colonels.
J'ai écrit deux fois dans ma vie sur le NON grec à Mussolini, du 28 octobre 1940, que les Grecs commémorent aujourd'hui, puisque c'est la date de leur seconde fête nationale (la première est le 25 mars, anniversaire du début de la guerre d'indépendance de 1821).
La première fois, c'était en romancier. Mon premier roman, Les Ombres du levant (il n'est plus disponible en version papier éditée par Critérion en 1996, mais il l'est en version numérique rééditée par H&O en 2013) est tout entier un hommage à la Grèce et aux Grecs qui savent (parfois) dire NON... et de quelle manière !
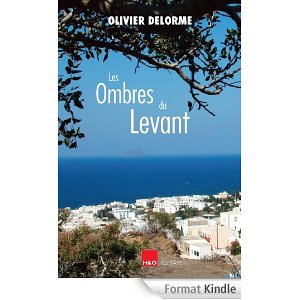
Intitulé "Alexandre-Athènes", le chapitre VIII (extrait ci-dessous) suit le héros , Alexandre Granier d'Hautefort dans une mission qui le conduit d'Alexandrie, où il a rallié la France Libre, jusqu'à Athènes où il est chargé par de Gaulle d'obtenir de Métaxas qu'un contingent de Français libres puissent venir se battre au côté des Grecs. proposition attestée historiquement et que Métaxas repoussa en raison des ambiguïtés que l'on trouvera exposées dans mon précédent post, celui de l'historien...
"En rade de Tinos, ancré à quelques encablures : le croiseur Helli, gloire et orgueil de la marine grecque ; de la marine grecque protégée par la Vierge. La marine grecque - celle des trières de Thémistocle, victorieuses à Salamine de l'hybris du Mède, celle des caïques de Miaoulis tenant la mer contre le Turc ; le Helli venu lui aussi pour honorer la Vierge.
Car le 15 août 1940, comme tous les 15 août, toute la Grèce converge vers Tinos pour déférer au culte. Toute la Grèce de Grèce - des potouria de Thrace, grises brodées de noir, aux Crétois en bottes avec leurs filets noués sur l'œil, à la pirate, l'air farouche comme il se doit -, mais aussi celles de Chypre, d'Égypte, d'Australie et d'ailleurs. Au culte de la Vierge, mais aussi des gloires de l'Antiquité, de Constantinople et de la résistance de l'hellénisme à quatre siècles d'occupation ottomane. Toute la Grèce processionne et communie - dans le tumulte et le recueillement -, au long de la rue rectiligne qui grimpe jusqu'à la Panaghia Évanghélistria où trône l'icône miraculeuse. Toute la Grèce, des mousses aux armateurs, piétine en plein soleil, des heures durant, au milieu des hurlements des gosses ivres de fatigue, pour embrasser la Vierge, la remercier d'un bienfait passé ou lui en réclamer de nouveaux, du ton du bon droit - celui dont on use avec le fonctionnaire à qui on a glissé le billet - plus que de la supplique. La ferveur et la cohue. Le bagout des vendeurs de nougat de Syros avec leurs grands paniers d'osier, mêlé aux litanies, et les odeurs de pain chaud ou de brochettes à celle de l'encens. Tous, les malades sur des civières, traînés, poussés au travers de la foule, portés au-dessus d'elle parfois, et les ravis qu'on amène chaque année, pour la forme. Tous, avec, serré dans la main de la putain aux ongles écarlates comme dans celle de la dame manucurée deux fois la semaine ou dans la poigne calleuse de la paysanne, l'ex-voto - le même que ceux qu'on accrochait dans les temples païens - en forme d'œil, de maison ou de caïque qu'on déposera dans la grande boîte à lettres juste à côté de l'icône. Tous, élus et réprouvés, avec des cierges plus hauts qu'eux encore enveloppés de papier rouge, avancent pas à pas, dans une cacophonie de haut-parleurs nasillards égrenant la kyrielle des saints à honorer, de cris des vendeurs de copies de l'Icône et des débitants de limonade, tonnelets en bandoulière, parmi les effluves de kokoretsi - des entrailles de moutons montées en andouillettes ; et aussi parmi ceux de l'encens. Ils se tassent, s'entassent, s'écrasent ; plus encore quand passe une procession : novices par devant, soutanes bleues gonflées de vent pareilles à des parachutes, popes en chasubles plus lourdes que des tabliers de sapeur, et toutes sortes d'archimandrites, d'higoumènes ou de métropolites, bulbe étincelant en tête, escortant une icône venue en visite, qui plisse les paupières d'être brandie ainsi, en pleine lumière. Pendant qu'en bas les navires continuent à accoster et vomir d'autres cargaisons de pèlerins habillés chez les meilleurs tailleurs de Londres et New York, ou bien en fustanelles et bas de laine brute. Et tout et tous se mêlent : les soies de Corfou palpitant au meltem et les uniformes, les étendards bleus et blancs et les bannières sacrées, le parfum des beignets au miel - les loukoumades croquants et brûlants - et celui de l'encens.
Avec au large le Helli, tous pavillons et fanions multicolores au vent, équipage immaculé dans l'azur, aux couleurs du drapeau, garde-à-vous et saluts au sifflet de rigueur. Ciel pur, serein, limpide ; légèreté de l'air et cœurs gonflés de l'inflexible fierté d'être Grec. Puis, tout à coup, un fracas abominable. La foule qui se retourne vers la mer, s'interroge. Et Le Helli qui se couche sur le flanc. S'engloutit dans les flots. Des milliers de regards médusés. Et La Vierge qui pleure. Le deuil. Et la fureur qui monte. Comment ont-ils osé, comment ont-ils pu à Tinos, le 15 août 1940 ?
Qui ? Métaxas interdit la publication des résultats de l'enquête identifiant des torpilles italiennes ; mais quel besoin avait-on d'expertises officielles ? Les provocations du Duce qui ne cessèrent de tout l'été, suffisaient à désigner le coupable. L'Albanie du roi Zog, occupée à vélo en 39, n'était qu'amuse-gueule et le Mare Nostrum devait redevenir ce lac romain sur lequel avaient jadis régné les aigles de Pompée. Métaxas en appela à Berlin ; convoqué au Brenner, Mussolini déploya des trésors de persuasion : la conquête de la Grèce ? une promenade de santé jusqu'aux bains de mer. En vain. Bouché, le Führer ; il maintenait son veto. Mais lorsque Benito apprit qu'à l'heure où il embrassait Adolf, les troupes nazies entraient en Roumanie sans qu'on n'ait cru bon de le mettre au parfum, il estima venu le moment pour César de se faire rendre enfin ce que l'on refusait de reconnaître sien.
Le 28 octobre 1940, à une heure trente du matin, le chiffreur de l'ambassade d'Italie à Athènes, ébahi, pénétra, sa dépêche à la main, chez le second secrétaire de permanence à la chancellerie. À une heure quarante, le téléphone sonna chez le premier conseiller qui, ne parvenant pas à y croire, finit tout de même par prescrire de réveiller Son Excellence. À deux heures, l'ambassadeur Grazzi qui s'était démené comme un beau diable pour que le fils de Puccini participât deux jours plus tôt à l'inauguration de l'Opéra royal de Grèce, n'en crut pas ses yeux embrumés de sommeil. À deux et demie, il enfila sa jaquette, leva les bras au ciel et, dans un geste d'impuissance, les laissa retomber. À deux heures quarante-cinq, on commença de brûler les archives. Et à trois heures, Grazzi remit à un Métaxas en robe de chambre et stupéfait, l'ultimatum qui exigeait, avant qu'aient sonné six, la libre circulation en Grèce pour les troupes italiennes.
La félonie après le sacrilège ! OXI (NON), c'est ce que le peuple unanime répondit, inscrivant les trois lettres en pierres peintes à la chaux au flanc de tant de ses collines - comme un serment -, pendant que les matons s'employaient à faire évader ceux de leurs prisonniers qui voulaient s'engager... sous les ordres de ceux qui, hier, les avaient torturés. Métaxas suivit plus qu'il n'entraîna, mais tous les hommes libres respiraient désormais au rythme de la frénésie victorieuse de la Grèce. Car les Evzones ne sont pas des soldats d'opérette en jupettes et Pavlos était déjà loin en Albanie lorsque j'arrivai à Athènes. C'est par sa sœur, rentrée de Londres dès le torpillage du Helli, que j'eus les premières nouvelles de lui. Éléni venait d'entrer dans ma vie.
SAMEDI 7 JANVIER 1941 : Cette fille est épatante. Teint sombre d'une olive de Kalamata, nez long et anguleux, chevelure et regard noirs aux reflets d'acier trempé : son profil tient plus du rapace - ceux qui planent sur les contreforts du Taygète, le pays d'où elle vient - que de la Vénus de Milo. Grande, une tête de plus que moi, port fier, col roide, elle est taillée en force ; rien qui évoque la fragilité ni le doute. J'adore ses coups de tête secs, impérieux, pour renvoyer sa crinière en arrière : une impératrice byzantine retournant un plat en cuisine ou refusant la grâce d'un condamné à mort. Elle a quatre ans de plus que Pavlos. Et que moi.
"Alexandre,
J'ai pleuré quand j'ai su ce qui est arrivé à la France mais les traîtres auront beau faire, on ne tue pas l'âme des peuples et sûrement pas celle de la France ni de la Grèce. De Gaulle sera votre Thémistocle et je suis fier que tu aies pris rang parmi les siens. Nous, sans rien, nous tenons tête. Mais nos pieds, s'ils continuent malgré tout de danser, commencent à geler. Il nous faut un Victor Hugo : qu'on nous donne de la poudre, des chaussettes et des balles et nous irons jusqu'à Rome ! et pourquoi pas jusqu'à Paris et Berlin ! Nous sommes les nouveaux soldats de l'An II car cette guerre est une révolution ; c'est elle qui donnera la liberté à notre peuple parce que notre peuple réapprend à se battre pour sa liberté. Je t'embrasse et te serre fort sur mon cœur.
Pavlos"
DIMANCHE 12 JANVIER 1941 : Il paraît qu'on commence à murmurer en haut lieu que ma mission est inopportune, ce qui n'est guère étonnant puisqu'on vient aussi de faire savoir officieusement au Comité des Français libres d'Athènes que l'ouvroir de tricotage des dames est la manifestation la plus publique qu'on puisse tolérer de sa part. Il est vrai que les gelures font plus de victimes que les fascistes et qu'on tricote à Athènes presque autant qu'on ampute. Éléni, au retour de la promenade dominicale de tout le monde, celle qui consiste à aller voir de près les files de prisonniers italiens et alors que je me lamentais sur mon inutilité : "Mais cesse donc de te faire des illusions, mon pauvre Alexandros, cette guerre ils n'ont aucune envie de la gagner.
- Ben voyons, ils ont envie de la perdre, sans doute !
- Mets-toi ça dans le crâne, ''paidi mou"' - elle me parle en français, mais ces petits mots, ce «mon enfant» de celui qui a vécu au blanc-bec, elle me les dit en grec -, les vôtres avaient une revanche à prendre (plutôt Hitler que Blum), les nôtres c'est bien pire, ils ne seront vaincus que si le peuple l'emporte. Métaxas, s'il n'avait pas dit non, aurait été balayé ; mais lui et les siens sont des fascistes... censés se battre contre des fascistes ? Foutaise et hypocrisie, oui !" Puis elle s'est approchée de moi, m'a passé tendrement la main dans les cheveux. Et m'a embrassé. Sur les lèvres.
J'étais ébranlé. Et troublé. Je ne savais déjà résister ni aux désirs ni aux arguments d'Éléni. Et puis il fallait bien se rendre à l'évidence : Métaxas considérait notre aide éventuelle comme une source de "complications" - donc à fuir comme la peste - avec l'ambassade de Vichy autant qu'avec les Allemands. Ce que confirmaient mes contacts du côté du Bretagne - de l'hôtel Grande-Bretagne, mais tout le monde disait alors le Bretagne. Réquisitionné, le palace de la place Syntagma était alors le vrai centre névralgique de la Grèce où déambulaient, s'affairaient et déprimaient toutes sortes de militaires, de politiciens et de fonctionnaires plus ou moins intéressés à la conduite de la guerre. Où je déambulais aussi en faisant mine de m'affairer, et déprimais souvent. Où Georges Séfériadis - Séféris de son nom de plume -, un diplomate dont Seyrig m'avait parlé comme d'un ami, portait aux étrangers la bonne parole de ceux qui l'avaient naguère envoyé en pénitence pour vénizélisme comme consul en Albanie. "Ce cher Henri (je venais de me présenter de sa part), comment se porte-t-il ? Venez donc dîner demain à la maison, jeune homme, nous en causerons plus à notre aise.
LUNDI 27 JANVIER 1941 : L'attaché américain avec qui j'ai sympathisé au Bretagne lors des conférences de presse de Séféris, m'a proposé de faire passer du courrier pour la France - hors censure - par la valise diplomatique de l'ambassade américaine à Vichy. Désormais, pour Rod et Biche je serai donc Alexander Benjamin Murphy... Junior. Car bien sûr c'est à Rod et à Biche que j'ai écrit d'abord.
Hier soir je suis allé dîner chez Séféris et Marô : curiosité dévorante et discrète, mais surtout une chaleur immédiate. Parce que je suis français ; et un Français qui n'a pas trahi l'idée que Séféris se fait de la France : "On me dit que Gide a accepté de travailler pour la N.R.F. de Drieu ; savez-vous si c'est vrai ? Avec de l'angoisse dans la voix.
- Non, je ne sais pas.
- Voyez-vous, je crois que je préférerais qu'on m'annonce sa mort. Nous avons été tellement abreuvés de dégoût depuis juin... quand j'ai reçu les premiers journaux de Paris, j'ai eu l'impression de ne plus rien comprendre à cette langue que je croyais celle de l'intelligence et qui ne semblait plus capable que de charrier la bêtise la plus noire." Je lui confie mon découragement devant les dérobades de mes interlocuteurs grecs : "Les hôtels, savez-vous Alexandre, ne valent rien à la politique : vous avez ceux de Vichy ; mais le Bretagne est un pourrissoir du même genre. Au Bretagne on n'est soucieux que de ne pas «provoquer» le Führer. Regardez-les virer au rose, nos chefs de guerre, dès que le ministre du Reich se félicite devant qui veut l'entendre, c'est-à-dire devant tout le monde, de l'estime qu'Hitler porte à Jean Métaxas, et blêmir quand il précise que le chancelier ne pourra pas éternellement retenir les Bulgares de foncer sur Salonique si nous autres Grecs nous continuons de «persécuter les Slaves macédoniens» ; regardez-les bien, Alexandros, et vous aurez tout compris.
Métaxas est en fait un Pétain qui se serait résigné à lancer l'appel du 18 juin. Mais ni lui ni le roi n'a compris que le NON du 28 octobre était une résurrection, comme en 1821 l'insurrection contre les Turcs, le refus instinctif du peuple face à l'abîme devant lequel se trouve l'Occident pour avoir renoncé depuis si longtemps à ses propres valeurs, celles de l'humanisme. La France a bien des malheurs mais elle a une chance, celle d'avoir en de Gaulle un vrai chef, viril et démocrate, qui incarne ce refus, la permanence malgré tout du génie de son peuple. Alors que nous, depuis la mort de Vénizélos, nous n'avons que des démagogues et des tyrans, les mêmes depuis Cléon et Pisistrate ; mais pas un Périclès."
Le 28, je reprenais l'avion pour Alexandrie où les prisonniers italiens excitaient, comme à Athènes, la curiosité dominicale des braves gens. Les Anglais, après avoir repris Sidi Barani et refait le terrain perdu en Égypte, semblaient ne plus pouvoir s'arrêter dans leur conquête du désert libyen..."